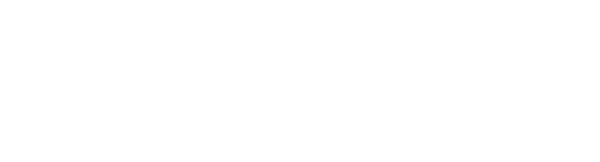Pourquoi le contrôle est un enjeu clé dans les relations professionnelles
Dans toute relation, qu’elle soit personnelle ou professionnelle, une question revient tôt ou tard : qui contrôle quoi ? Dans un groupe, après les premières étapes d’inclusion et de prise de contact, les membres commencent à chercher leur place. Les rôles émergent : leader, aidant, opposant, conciliateur, joker… et avec eux, les dynamiques de pouvoir.
Les problèmes de contrôle apparaissent souvent à ce moment-là. Les individus cherchent à influencer, à guider ou à résister. Des tensions peuvent surgir autour de la légitimité, des responsabilités et de la capacité à décider.
Le contrôle devient alors un enjeu relationnel :
Qui a le dernier mot ?
Qui prend les décisions ?
Qui détient l’information ?
Contrôle rationnel vs contrôle défensif
Face à ces situations, notre comportement peut être de deux natures :
La partie rationnelle : flexible, adaptée, capable de prendre en compte les besoins des autres et d’ajuster son comportement.
La partie défensive : rigide, souvent motivée par la peur de perdre la face, de perdre du pouvoir ou d’être humilié.
Plus notre conscience de soi et notre estime personnelle sont élevées, plus nous pouvons adopter un comportement rationnel et constructif, plutôt que défensif et conflictuel.
Contrôle et sentiment de compétence
Le contrôle ne se limite pas à l’influence sur les autres. Il est intimement lié à notre sentiment de compétence et de choix.
La compétence renvoie à notre capacité à prendre des décisions, à résoudre des problèmes et à produire des résultats.
Le choix implique que nous croyons être acteurs de notre vie, capables de changer ce qui doit l’être dans nos comportements, nos relations ou notre situation professionnelle.
Un manque de sentiment de compétence ou de choix peut mener à :
Une recherche excessive de contrôle sur les autres.
Une rigidité dans la façon de diriger ou de collaborer.
Des réactions défensives en cas de désaccord ou de remise en question.
Responsabilité plutôt qu’accusation
Les différences d’opinion sur ce qui « ne va pas » dans une situation de travail conduisent souvent à l’accusation :
« C’est de sa faute si nous en sommes là. »
« Si seulement ils avaient fait leur part… »
Or, adopter cette posture enferme les individus dans un jeu de pouvoir destructeur. La clé est de prendre 100 % de responsabilité pour notre contribution à la situation – sans chercher à accuser.
Chaque personne impliquée aurait pu agir différemment, influencer autrement, proposer une autre solution. Cette posture de responsabilité permet de passer d’un climat de reproche à une logique de résolution de problème :
Nous voyons le problème comme un ennemi commun.
Nous travaillons ensemble pour trouver des solutions.
Nous évitons de nous attaquer mutuellement, ce qui réduit la défensive.
Les peurs qui se cachent derrière le contrôle
Le contrôle est souvent motivé par des peurs inconscientes :
Crainte interpersonnelle : être humilié, exposé, vulnérable.
Crainte personnelle : se sentir incompétent, incapable, imposteur.
Ces peurs peuvent conduire à la domination (vouloir être « au-dessus ») ou à la soumission (se mettre « en dessous » pour éviter le conflit). Trouver un équilibre, c’est accepter la confrontation sans la dramatiser, et rester dans un dialogue adulte-adulte.
Développer une posture de contrôle saine
Pour les dirigeants et managers, développer une relation saine au contrôle est une compétence clé de leadership. Voici quelques pistes :
Cultiver la conscience de soi
Identifier ses déclencheurs émotionnels, ses réactions défensives et ses peurs cachées.Renforcer le sentiment de compétence
Se former, s’entourer, déléguer intelligemment pour se sentir légitime dans ses décisions.Choisir la confrontation constructive
Voir les désaccords comme des opportunités d’apprentissage plutôt que comme des menaces.Partager le pouvoir
Impliquer les collaborateurs dans la prise de décision, renforcer leur autonomie et leur responsabilité.
Conclusion : du contrôle à l’autodétermination
Le contrôle, dans sa version défensive, enferme et crée des luttes de pouvoir. Dans sa version rationnelle, il devient un moteur d’autodétermination, de compétence et de choix.
En apprenant à prendre notre part de responsabilité, à clarifier nos besoins et à collaborer sur les solutions plutôt que sur les accusations, nous transformons le contrôle en un levier de croissance personnelle et collective.
C’est dans cette posture que le leadership devient véritablement libérateur : ni domination, ni soumission, mais une capacité à orienter, décider et inspirer sans écraser.